Table des matières
Je m'appelle Santiago Rivas. Je suis le gardien des phares d'Ibiza et de Formentera. J'ai passé toute ma vie dans les phares.
Jusqu'à mes seize ans, j'ai vécu au Faro de la Mola, sur l'île de Formentera – au bout du monde, là où la terre s'arrête et où la mer commence à respirer. Ensuite, il y a eu San Antonio, puis Covas Blancas. Depuis 1996, je suis à Botafoch. Mais La Mola, c'est mon enfance. Mon premier silence.
Le dernier silence
Il n'y avait pas de téléphone. Pas d'internet, évidemment. Tout se transmettait de bouche à oreille. Pour parler à quelqu'un, il fallait se déplacer. À pied. Ou plus tard, pour les plus chanceux, à vélo.
Il fallait une semaine pour répondre aux lettres. Parfois deux. Puis on attendait la réponse. Encore une semaine. C'était le rythme. C'était comme ça que ça se passait.
Si nous voulions acheter quelque chose – un outil, un livre, par exemple – nous voyions une annonce dans le journal. Nous remplissions un formulaire. Nous l'envoyions. Nous attendions. Je ne me souviens plus comment nous payions. Par virement bancaire, peut-être. Mais il fallait des semaines avant que le colis n'arrive.
Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton. L'objet est là demain.
Mais nous n'avions pas besoin de tout cela. Nous pouvions vivre sans beaucoup de choses qui nous paraissent aujourd'hui indispensables. Et nous étions – du moins je le crois – tout aussi heureux que les gens d'aujourd'hui, malgré tous leurs biens.
L'ami, à un kilomètre de là
Mon ami le plus proche habitait à presque un kilomètre. Pour un enfant, c'était loin. Très loin. J'allais le voir à pied. Il venait me voir. On jouait.
Nous avions quelques jouets en plastique – pas beaucoup – mais surtout, nous inventions nos propres jeux. Nous jetions des pierres dans la mer. Pendant des heures. Nous les regardions voler dans les airs, effleurer l'eau – d'abord silencieusement depuis la hauteur, puis l'éclaboussure, puis les cercles qui s'étendaient et disparaissaient. Chaque pierre, une petite histoire. Chaque lancer, un événement.
La mer a toujours eu son temps. Nous aussi.
Nous n'étions pas scotchés aux écrans toute la journée. Impossible. Il fallait faire appel à notre imagination. Sinon, on s'ennuyait. Quand on est jeune, on s'ennuie vite ; on a besoin d'activité, de mouvement. Mais nous, nous avions la mer. Nous avions le ciel. La nuit, les étoiles, si nettes qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Le jour, le bleu infini.
Le vélo a tout simplifié. Soudain, le kilomètre n'était plus un problème.
Le navire de Marseille
Il y avait un navire. Un grand navire qui passait une fois par semaine. La plupart des navires ne s'approchaient pas autant de La Mola – il n'y avait aucune raison de le faire. Mais celui-ci, le Masalia de Marseille, venait régulièrement. Toujours à la même heure.
Nous l'attendions.
Nous avions le drapeau officiel du phare. Fixé à un long mât. Quand la Masalia est arrivée, nous avons couru jusqu'au bord de la falaise. Le vent arrachait le drapeau, nos cheveux, nos chemises. Nous l'agitions. Frénétiquement. À deux bras.
Et le navire répondit.
Le klaxon. Fort. Long. Un son qui portait au-dessus de l'eau et s'écrasait contre les rochers. Un salut du vaste monde qui venait à nous et repartait.
Pour nous, c'était fantastique. C'était de la communication. C'était du lien. Un bateau venu de France nous a accueillis à notre retour. On ne nous avait pas oubliés. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand.
Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais c'était suffisant.
Des étrangers arrivent, des étrangers partent
Puis ils sont arrivés. Des étrangers aux cheveux longs, aux vêtements colorés, aux idées différentes. Les hippies. Ils louaient les vieilles maisons – à moitié en ruine – pour une somme modique. Ils apportaient de l'argent et un nouveau mode de vie. Certains habitants les appréciaient. D'autres non. Mais il n'y a pas eu de grands conflits. Ils n'étaient que de passage. Des invités. L'île est restée telle quelle.
Puis vint le tourisme. Le vrai. En masse. Les gens que je connaissais – les agriculteurs, les pêcheurs – se transformèrent. Soudain, des restaurants. Des appartements. De l'argent. L'île changea avec eux.
Mais le phare était toujours là. La lumière était toujours là.
La lumière
La nuit, quand le phare allume sa lumière, il projette de longues ombres sur l'eau. Quatre secondes de lumière. Quatre secondes d'obscurité. Quatre secondes de lumière. Un rythme plus ancien que le silence de mon enfance.
La lumière avertit. La lumière guide. La lumière dit : Voici les rochers. Voici la terre ferme. Ici, tu es en sécurité.
Les navires d'aujourd'hui ont besoin du GPS, de satellites et d'ordinateurs. Ils n'ont plus besoin de la lumière comme autrefois. Mais elle continue de brûler. Par tradition. Par sécurité. Par respect pour ceux qui s'orientent encore grâce à elle.
J'ai passé ma vie entre lumière et ténèbres. Entre terre et mer. Entre silence et bruit. Et la lumière continue de tourner. Chaque nuit. Sans se demander si quelqu'un la regarde.
Il est tout simplement là.
Entre les temps
Aujourd'hui, j'habite à Botafoch. Un autre phare. Plus près de la ville. Plus près du bruit. Je suis plus âgé maintenant. J'ai vu beaucoup de changements. Beaucoup de transformations.
Les jeunes d'aujourd'hui… parfois, je ne les comprends pas. Ils sont constamment devant leurs écrans. Connectés en permanence. Mais sont-ils vraiment connectés ? Ou simplement seuls ensemble ?
Il fallait aller à la rencontre des gens pour leur parler. Marcher un kilomètre. Écrire des lettres. Attendre des semaines. C'était long. Mais c'était concret. Quand quelqu'un disait « Je viens demain », il venait. Ou il ne venait pas, et on savait alors que quelque chose s'était passé.
Aujourd'hui, tout est instantané. Mais est-ce mieux ?
Je ne sais pas. Peut-être suis-je simplement vieux. Peut-être que je pense comme toutes les générations : les jeunes font fausse route. Mais ensuite, ils vieillissent et pensent la même chose de la génération suivante.
C'est peut-être là le cycle. Comme la lumière. Quatre secondes de lumière. Quatre secondes d'obscurité.
Ce qui reste
Quand je repense à La Mola – à la falaise, au vent, au drapeau, au bateau venu de Marseille – je me dis : nous avions peu. Mais nous avions assez.
La mer était toujours là. Les étoiles étaient toujours là. L'ami, à un kilomètre de là, était là. Le navire répondit par un salut.
Cela suffisait.
L'île a changé. Les gens ont changé. Mais la lumière continue de tourner. Chaque nuit. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes.
Un rythme qui demeure quand tout le reste disparaît.
Voilà ma vie. La lumière entre ciel et mer.
Santiago Rivas, gardien de phare, vit et travaille depuis 1996 au phare de Botafoch. Il a passé son enfance au Faro de la Mola, à Formentera – le dernier havre de paix avant que le monde ne devienne bruyant.



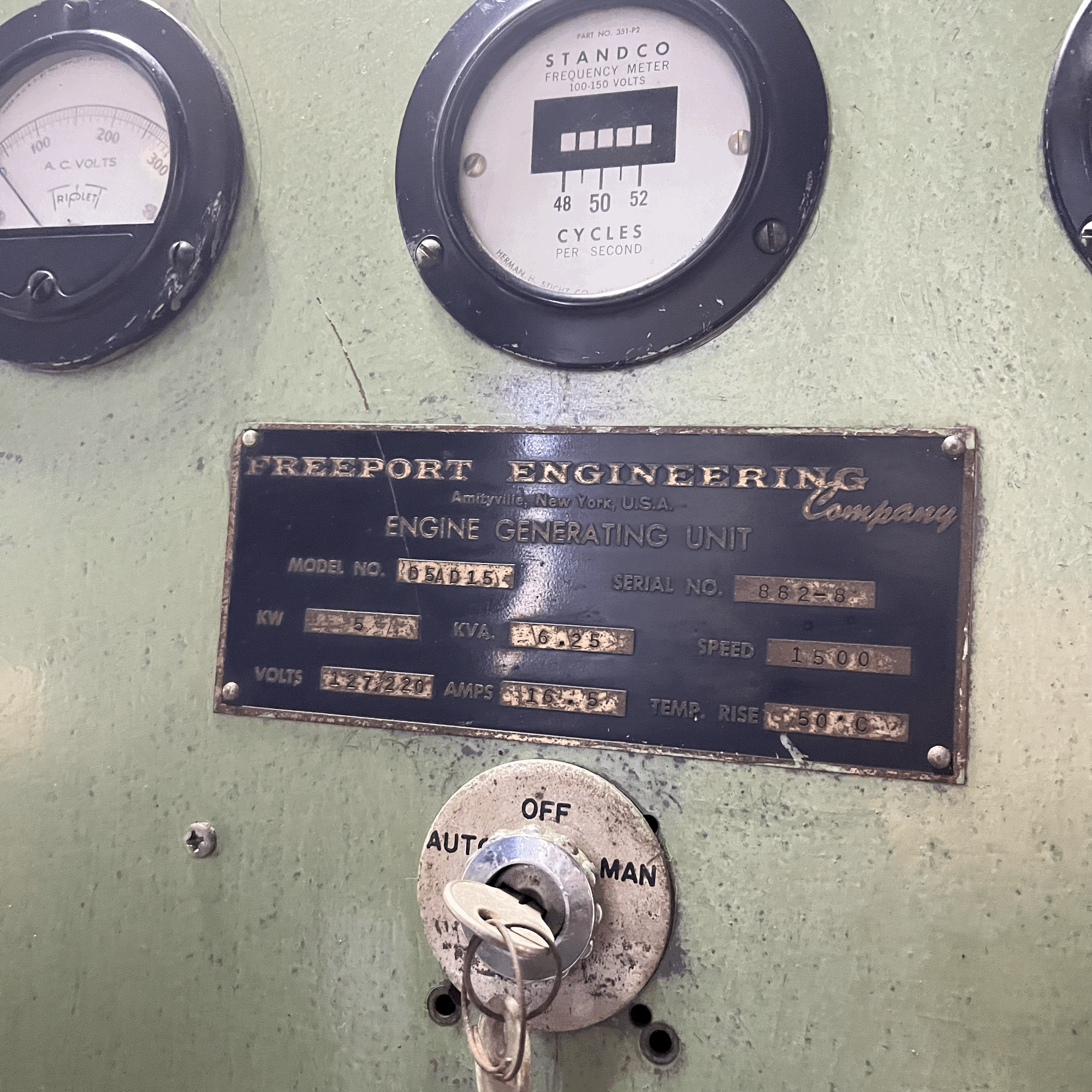
Phare de Bota Foch. Inauguré en 1861, le phare a célébré son 150e anniversaire en 2011 et sert de point de repère grâce à sa structure inhabituelle à deux étages.





